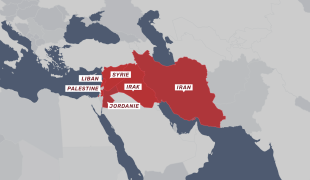Côte d’Ivoire : La chirurgie traumatique d’urgence en zone de conflit

Cristiana Bertocchi, chirurgienne travaillant avec Médecins Sans Frontières en Côte d'Ivoire, revient sur une semaine passée dans l'unique hôpital opérationnel du nord d'Abidjan, ville en proie à de violents affrontements.
Cristiana Bertocchi, chirurgienne MSF, revient d'une courte mission en Côte d'Ivoire où elle travaillait à Abidjan, dans le quartier d'Abobo. Le pays connaît une recrudescence de la violence et la ville d'Abidjan est l'une des principales zones touchées par les affrontements. Aujourd'hui, l'hôpital du ministère de la Santé d'Abobo Sud, où MSF est présente, est la seule structure de santé opérationnelle dans les quartiers nord de la ville. Ces trois dernières semaines, les équipes de l'hôpital ont prodigué des soins d'urgence à 273 patients, dont 225 blessés par balles.
Que pouvez-vous dire de l'hôpital d'Abobo Sud ?
L'hôpital est situé dans la zone la plus instable d'Abidjan et la plupart des habitants ont abandonné le quartier. Les routes pour aller de notre base à l'hôpital sont sinueuses et sans vie. Il n'y avait personne dans les rues. Des carcasses de voitures brûlées au bord de la route. Et des barrages en différents endroits. Parfois à ces barrages, des hommes en armes nous interpellaient et nous menaçaient.
À l'intérieur de l'hôpital, il n'y avait pas de violence. Mais nous n'en étions pas loin. On pouvait entendre des échanges de tirs à l'extérieur de l'hôpital, à n'importe quel moment de la journée. Et cela pouvait durer un moment, c'était parfois si proche que nous avions l'impression que les tirs avaient lieu à l'intérieur même de l'hôpital. Nous allions alors tous nous mettre à l'abri.
Quels types de blessures avez-vous soignées ?
Je n'étais pas à l'hôpital tous les jours de la semaine. Mais durant les premières 48 heures, nous avons reçu chaque jour entre 15 et 20 patients souffrant de diverses blessures par balles. Certaines étaient très graves. Durant les premières 24 heures, j'ai eu deux patients qui avaient reçu plusieurs balles à la tête et nous n'avons rien pu faire pour eux.
Les blessés arrivaient-ils en petit nombre ou massivement ?
Il y a eu un incident le 17 mars qui a été repris par les médias internationaux. Un obus, je crois, a été tiré sur un marché. Environ 60 patients ont été amenés à l'hôpital. Huit d'entre eux étaient morts à leur arrivée et huit autres sont décédés pendant le triage. Au départ, nous disposions d'un bloc opératoire totalement fonctionnel qui tournait sans interruption. Puis nous avons pu ouvrir une second bloc, mais nous n'avions qu'un seul anesthésiste, ce qui a limité nos capacités d'action.
Parmi ces blessés qui ont afflué, il y avait des hommes, des femmes et quelques enfants. La plupart souffrait de blessures causées par l'explosion, dont certaines étaient très graves. Une femme a eu ainsi un bras pratiquement arraché. Les muscles avaient été déchirés. Elle avait un énorme trou en haut du bras. Heureusement, aucun vaisseau majeur n'avait été touché et aucun os brisé. Nous avons également soigné un homme avec une main mutilée et d'autres avec des blessures abdominales profondes qui nécessitaient une opération. L'un d'eux est mort sur la table d'opération suite à une blessure artérielle.
Comment cela se passait dans l'hôpital ?
C'était extrêmement stressant. Il fallait faire un tri parmi les patients qui affluaient entre ceux qui avaient une chance de survivre et les autres tout en s'occupant de ceux qui devaient être opérés et de ceux qui sortaient du bloc... Et il y avait des patients que nous aurions pu sauver dans nos pays d'origine, dans des conditions plus calmes. Mais face à un tel afflux de victimes, quand il faut s'occuper de tellement de blessés au même moment, ce n'est malheureusement pas toujours possible... C'était une situation très difficile.
En même temps, nous n'avions aucune idée de la situation à l'extérieur en matière de sécurité. Nous avions le sentiment que l'hôpital était exposé. Avec l'afflux massif de blessés, nous avons travaillé dans l'hôpital au maximum de nos capacités pendant 48 heures, sans interruption. Les autres jours, nous opérions souvent jusque tard dans la nuit. Nous avions alors quelques heures pour nous reposer avant de reprendre le matin, quand de nouveaux blessés arrivaient.
La situation était-elle plus calme la nuit ?
Durant la nuit, les blessés devant être opérés étaient moins nombreux à arriver. Quand il fait noir, les personnes ont peur de se déplacer et il y avait beaucoup moins d'affrontements aux alentours.
Quels autres types d'opération ont été effectués ?
Nous avons pratiqué beaucoup de laparotomies pour des blessures par balles (4 à 5 en moyenne par jour), c'est une opération de chirurgie abdominale. Nous avons soigné des blessures aux intestins, à la vessie et au foie. Nous avons également fait des césariennes en urgence. L'hôpital a un service d'obstétrique et deux sages-femmes. Les patientes qui ne pouvaient accoucher normalement étaient amenées au bloc opératoire.
Il y avait également énormément de cas de fractures, de fractures ouvertes, de plaies ouvertes par balles qui nécessitaient un débridement et aussi des fractures par balle qui nécessitaient un débridement et la mise en place d'un fixateur.
Quels ont été les résultats ?
Le taux de réussite pour les patients que nous avons opérés était assez bon ; il en est de même pour leur pronostic de survie. Mais je le répète, il y avait énormément de patients. Les 24 premières heures, nous avons reçu deux personnes blessées par balle à la tête. Nous avons également eu deux patients souffrant de blessures par balles qui semblaient parfaitement stables à leur arrivée, mais qui sont décédés 15 minutes plus tard. Nous n'avons pas pu les amener au bloc à temps parce qu'il était déjà occupé.
J'imagine qu'ils souffraient de blessures internes. En me basant sur leurs blessures, je pense que l'un d'eux avait été touché au niveau d'une veine cave ou hépatique. Ce sont des cas très difficiles à opérer même dans des centres de traumatologie de pointe. En outre, avec tous les affrontements que l'on pouvait entendre de l'hôpital, on peut imaginer qu'un grand nombre de personnes n'a pas pu arriver jusqu'à nous.
Avez-vous déjà travaillé dans des conditions similaires ?
Non, jamais. D'après mes discussions avec d'autres membres du personnel MSF expatrié, je crois qu'eux non plus n'avaient jamais vécu une telle situation. Pour nous tous, c'était très stressant et difficile de travailler et de dispenser les soins de la qualité que nous sommes à même d'offrir dans des circonstances normales.
Votre précédente mission en Côte d'Ivoire avec MSF avait, semble-t-il, été très différente...
Ma première mission s'est déroulée à la fin du conflit en 2006. Nous étions en train de transférer la gestion d'un hôpital au ministère de la Santé. Dans un environnement pacifique. Cette fois, la situation était donc très différente et les conditions n'étaient pas comparables. Lors de ma précédente mission, je faisais de la chirurgie générale d'urgence. Là, c'était de la chirurgie traumatique d'urgence.
MSF est une organisation humanitaire médicale qui respecte strictement les principes de neutralité et d'impartialité lors de ses opérations. Ses activités en Côté d'Ivoire sont exclusivement financées par des donations privées, garantissant l'indépendance totale de l'organisation.
À Abidjan, MSF prend en charge les urgences dans l'hôpital d'Abobo Sud, en collaboration avec le ministère de la Santé.
Dans l'ouest du pays, MSF dispense des soins de santé primaire et soutient les hôpitaux de Duékoué, Guiglo et Bangolo.
Au Libéria, MSF apporte des soins de santé primaires dans le comté de Nimba, où de nombreux Ivoiriens ont trouvé refuge après avoir fui les violences dans leur pays.