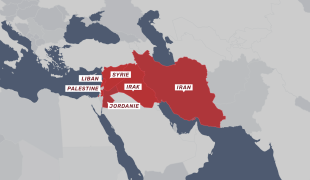La tragédie Rohingya, chapitre 2 : survivre au quotidien

En arrivant au camp de réfugiés de Kutupalong-Balukhali, la première chose qui frappe est sa taille. Près de 650 000 membres de la communauté Rohingya du Myanmar sont installés là, soit une population supérieure à celle de Lyon, la troisième ville la plus peuplée de France.
Contrairement à la plupart des grandes villes, ici les gens ont un accès très limité à l’eau potable, aux structures de santé ou à un hébergement décent. Les plus vulnérables, les personnes âgées et les enfants, ont la plus grande difficulté à atteindre les points de distribution de nourriture. Quand ils y parviennent, ils doivent faire la queue plusieurs heures.
Chapitre 2 : survivre au quotidien
Après avoir survécu à des décennies de persécution et aux récents massacres chez eux, les Rohingyas sont confrontés, ici, à une nouvelle réalité : même s’ils sont en sécurité au Bangladesh, pour l’instant du moins, leurs vies sont loin d’être tranquilles.
Il est difficile de croire qu’un camp de cette taille s’est constitué en trois mois. Les gens qui y vivent ont fui le Myanmar après les massacres du 25 août, durant lesquels, des hommes, des femmes et même des enfants ont été assassinés, au cours de violences imputées par les réfugiés à l’armée, à la police et aux milices armées.

Des bébés qui n'ont rien à manger
À Kutupalong, beaucoup de Rohingyas sont encore sous le choc de ce qu’ils ont vécu et l’atmosphère est lourde. Les femmes qui ont perdu leurs maris ont le plus grand mal à rassembler leurs forces pour sourire et s’occuper de leurs bébés. Les hommes dont les épouses ont été violées et tuées disent qu’ils ont perdu tout espoir.
Partout dans le camp, on voit des scènes où la misère se mêle à la saleté. De jeunes enfants, âgés d’un an ou deux, jouent dans des trous où la boue est mélangée à l’urine et aux excréments. Il y a des latrines, et les gens les utilisent, mais malgré les efforts de la communauté et des ONG pour développer des infrastructures en urgence, l’eau et les installations sanitaires sont une source potentielle de maladies.
Certaines latrines n’ont qu’un mètre de profondeur, et aucun système d’assainissement ou de pompage n’a été mis en place pour les nettoyer. Résultat : certaines sont remplies, d’autres bouchées, et les déjections s’infiltrent dans les fissures du revêtement en ciment et passent dans le sol. Cette situation représente un risque majeur susceptible d’exploser à tout moment.

En effet, un ou deux mètres plus loin, les gens pompent de l’eau dans des puits peu profonds, pour boire ou se laver. Ils ont été creusés en urgence pour faire face à un afflux massif de réfugiés. Mais leur profondeur n’oscille qu’entre 10 et 20 mètres sous la surface, avec deux risques significatifs.
Tout d’abord, l’eau a de fortes chances d’être contaminée. Les données publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indiquent que la semaine du 19 novembre, 58 % des échantillons d’eau testés à partir des puits ou directement dans les foyers des réfugiés sont fortement ou très fortement contaminés par des matières fécales. Cela engendre des problèmes sérieux pour la population, et notamment pour les femmes enceintes et les jeunes enfants, plus exposés aux conséquences des diarrhées et risques d’hépatite E. Deuxièmement, alors que la saison sèche approche, les puits risquent de se tarir, à cause de leur faible profondeur.
De difficiles conditions d’accès à l'eau potable
Les équipes MSF essayent de maintenir une isolation entre les puits de forage et les latrines, en forant plus en profondeur dans le sol, pour tenter d’approvisionner les structures de santé et la population du camp en eau potable.
L’ampleur des besoins est immense. Il faudra un effort conséquent pour rendre les conditions de vie dans le camp supportables.

Avant qu'Al Maskata, 25 ans, n’arrive dans le camp en septembre, elle allaitait sa fille de sept mois, Norshe. « Mais je n’ai plus de lait, et je ne peux plus la nourrir », explique-t-elle.
Non seulement le lait maternisé est très rare dans le camp ; mais l’eau pouvant être contaminée, il serait dangereux de l’utiliser pour la mélanger au lait. Les bras et les jambes de Norshe sont émaciés et son ventre est gonflé à cause de la malnutrition dont elle souffre. Elle a de la diarrhée, de la fièvre et elle sourit et bouge à peine.
Un autre réfugié a donné à Maskata des légumes pour qu’elle les cuisine pour son enfant, mais ne pouvant pas les digérer, elle vomit dès que sa mère tente de la nourrir.

« Les ONG distribuent de la nourriture pour les adultes mais je n’ai pas trouvé de lait pour mon bébé. J’habite au sommet de la colline, et c’est difficile pour moi d’aller jusqu’aux points où l’on distribue la nourriture », détaille Maskata, dont le mari a été tué au Myanmar.
En guise d’alternative, elle essaie de nourrir Norshe avec de l’eau de riz bouillie. Mais ce n’est pas suffisant et sa fille a faim en permanence.
« Je m’inquiète surtout pour mes enfants. La vie n’était pas idéale dans l’état de Rakhine [au Myanmar]. C’était dangereux et instable. Mais au moins on avait une petite ferme et un peu d’argent », poursuit Maskata.
« Depuis deux mois, mes enfants sont malades en permanence. C’est normal : regardez la saleté du camp dans lequel on vit. »
Reflétant la gravité de la situation des enfants du camp, la majorité des patients de MSF sont âgés de moins de cinq ans. Les principaux problèmes que les médecins ont à traiter sont les diarrhées, les problèmes respiratoires, et plus récemment des cas de diphtérie. Il y a également eu une épidémie de rougeole, qui a été la principale cause d’hospitalisation et de mortalité. La couverture vaccinale est encore problématique malgré une récente campagne de vaccination.
[La tragédie Rohingya] Centre de santé MSF
Vivre dans le dénuement
Pour Dilaforuz, qui a près de 100 ans, la vie est extrêmement rude. Elle est arrivée dans le camp avec son fils, Solim – qui l’a portée sur son dos pendant huit jours du Myanmar au Bangladesh –, sa belle-fille Jahura, ainsi que ses six petits-enfants.
Malgré son âge avancé, sa santé était meilleure avant que sa famille ne soit chassée d’un village appelé Tombazar à la fin de l’été. Les médecins locaux lui rendaient fréquemment visite, et lui fournissaient les médicaments dont elle avait besoin.

Mais ici, elle se meurt. Elle peut à peine respirer à cause d’un asthme sévère. Elle ne peut pas manger de nourriture solide et ne parvient pas à parler tant elle manque de souffle. Elle pleure fréquemment, et doit sa survie à son fils et sa belle-fille qui la nourrissent avec des boissons sucrées.
« Ici on vit avec rien, mais au moins on est en sécurité. Notre principal problème c’est que ma belle-mère est malade. J’espère qu’une ONG pourra nous aider et lui fournir une assistance médicale. Ça nous attriste beaucoup de l’entendre souffrir et tousser jour et nuit », déclare Jahura.
« Cela nous aiderait si mon mari pouvait trouver un travail. Mais c’est impossible dans le camp, et nous n’avons pas le droit d’aller dans la ville de Cox’s Bazar pour chercher un emploi », indique-t-elle, en ajoutant que les checkpoints des autorités bangladaises empêchent les Rohingyas de quitter le camp.
Pour Zulcher, 65 ans, qui a fui la ville de Bosedong, la vie dans le camp voisin de Balukhali est un combat quotidien. Comme des centaines d’autres, elle a passé sept heures à attendre dans la queue à un point de distribution de nourriture. Elle se souvient, en pleurant, de son fils Aladdin brûlé vif par des soldats birmans au Myanmar. Il avait 25 ans.
Sous un soleil brûlant, elle lutte pour garder espoir et pour s’occuper de son fils de 20 ans, Mohammad, qui est avec elle dans le camp. C’est elle qui doit rester debout dans la queue, parce que son fils est trop malade pour quitter son abri.
« Personne ne va nous tuer ici, concède-t-elle, mais je souffre pour subvenir à nos besoins les plus basiques. »
La vie de Zulcher est remplie de tristesse, mais il n’y a pas de peine égale à celle de Mohammad Rafik dont le fils d'un an, Mohammad Ayoub, est mort d’une pneumonie dans le camp.
Rafik et sa famille ont aussi dû fuir la ville de Bosedong fin août.